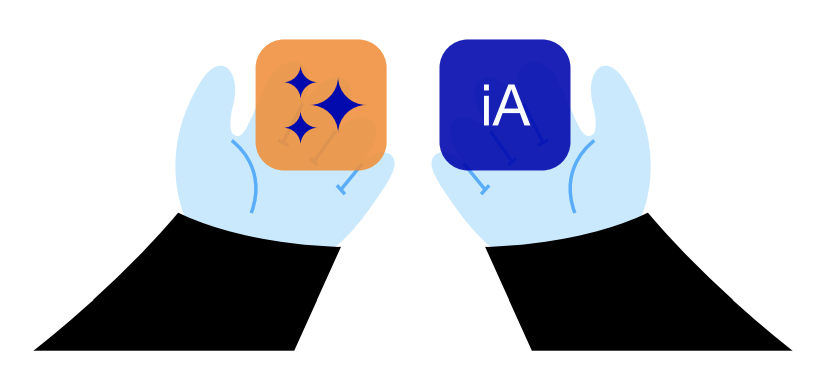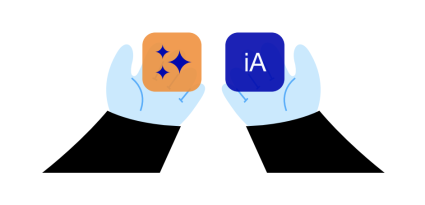
Le Shift Project : éclairer et influencer le débat sur les défis climat-énergie
Quel est vraiment l’impact climatique et énergétique des centres de données et de l’IA ? Le Shift Project, un think tank spécialiste de la transition énergétique, s’est posé cette question alors que des investissements massifs dans le matériel et des projections de l’IEA prévoient un doublement de la consommation électrique des data centers entre 2024 et 2026.
Suite au rapport publié par le Shift en octobre 2025 (dont voici la synthèse), nous avons contacté Marlène de Bank, ingénieure depuis 3 ans au sein de la structure, pour discuter du déploiement rapide de l’IA et des data centers, sources massives d’émissions de carbone et de demande énergétique.
Une multiplication de data centers
Au niveau mondial, la consommation d’électricité des data centers en phase d’usage pourrait atteindre entre 1250 et 1500 TWh d’ici 2030, l’équivalent de deux fois les émissions totales de la France. Cela pourrait représenter une gigatonne de CO2, l’équivalent de deux fois les émissions totales de la France. C’est un chiffre colossal dans le contexte d’un monde visant la neutralité carbone où la capacité de neutralisation est estimée à seulement 5 à 7 gigatonnes, d’après Marlène de Bank.

Côté européen, la demande en électricité des data centers augmente plus vite que les capacités de production décarbonée, et entre en concurrence directe avec les besoins de la transition énergétique. La part dans la consommation nationale d’électricité est très hétérogène, pouvant atteindre 18% en Irlande, mais seulement 4,6% au Danemark. Deux tiers de la consommation énergétique des centres de données sont concentrés dans quatre pays : Allemagne, France, Pays-Bas et Irlande, alors qu’ils ne rassemblent que 40% de la population européenne. Cette concentration révèle aussi une course à la capacité : certaines entreprises multiplient les précommandes dans différents pays européens pour maximiser leurs chances d’obtenir une capacité installée suffisante. Le Shift recommande la création d’une coordination européenne entre les gestionnaires de réseaux pour éviter ces dérives et de ne pas installer de data centers si la source d’énergie est fossile (gaz notamment).
Enfin, en France, le Shift Project s’est concentré sur les risques de conflit d’usage. Les data centers vont soit prendre l’énergie prévue pour l’électrification de l’industrie et des transports, soit exiger de nouvelles capacités de production, avec un quart exclusivement dédié à ces centres de données. Pour Marlène de Bank, il faut éviter de surdimensionner l’offre car un centre de données met trois ans à devenir opérationnel et d’ici là, le paysage énergétique et numérique peut avoir changé.
La demande énergique ne cesse de grandir
L’essor de l’IA repose sur une nouvelle génération de serveurs accélérés, dont l’impact environnemental dépend de multiples facteurs : la vitesse de renouvellement du matériel, sa durée de vie, son efficacité énergétique à chaque génération d’accélérateurs d’IA et le taux d’utilisation des machines.
Le poids du matériel n’est pas négligeable : au niveau mondial, 75% de l’empreinte carbone provient de l’utilisation et 25% de la fabrication du matériel. “En France, nous sommes sur du 50-50 en raison d’une électricité bas-carbone, cela met en lumière la nécessité de décarboner aussi la production du matériel”, explique l’ingénieure.
Au niveau mondial, la demande électrique grandissante des data centers exerce aussi une pression sur le secteur de l’énergie. Malgré la volonté d’utiliser de l’énergie bas-carbone, les petits réacteurs modulaires (PRM) et la géothermie ne pourront être fonctionnels au plus tôt qu’en 2030. D’après l’ingénieure du Shift, “On ne sait toujours pas s’ils ont la capacité de répondre aux demandes globales d’électricité. Et en attendant, la réponse immédiate à cette demande en hausse n’est possible que par des infrastructures fossiles, en raison de leur flexibilité et de leur facilité de déploiement.”
Un futur incertain
Pour se projeter et préparer ses recommandations, le rapport du Shift Project s’appuie sur les scénarios de Schneider Electric (2024), inspirés du design fiction :
- Sustainable AI : une croissance mesurée de l’IA, avec une installation de centres de données sur des systèmes énergétiques renouvelables.
- Limits To Growth : un développement de l’IA contraint par des limites énergétiques, économiques et de demande.
- Abundance Without Boundaries : croissance forte et sans entrave de l’IA, où les améliorations d’efficacité entraînent une augmentation des usages et donc de la consommation énergétique globale.
- Energy Crunch : expansion trop rapide de l’IA qui dépasse les capacités énergétiques disponibles, entraînant des pénuries et une crise énergétique plus large.
En réponse, le Shift Project préconise quatre mesures globales pour réduire les émissions et sortir de la dépendance aux énergies fossiles : la transparence sur ses bilans carbone, l’optimisation des infrastructures, la sobriété collective et le partage d’information.
“Le sujet de l’IA doit être traité comme n’importe quelle autre activité en entreprise. C’est-à-dire : réaliser un bilan carbone et vérifier qu’il rentre dans la trajectoire de l’entreprise, en suivant le volume total d’utilisations et le type de requêtes. L’utilisation de l’IA peut être comparée au plastique : indispensable pour certains usages critiques, mais à réduire dans le quotidien. » nous explique la chercheuse. « Côté communication, il est également important de vérifier chaque information rapportée car beaucoup d’infox, comme la requête = une bouteille d’eau, nuisent à une compréhension saine du problème. L’enjeu maintenant n’est pas de freiner l’innovation, mais de l’aligner avec les ressources disponibles.”